Dans le champ des enquêtes d’opinion, l’analyse par tranches d’âge reste la norme : elle permet de décrire les comportements selon les moments de la vie. Pourtant, un autre découpage, fondé non sur l’âge mais sur la génération d’appartenance, gagne du terrain. Ce regard « générationnel » ne propose pas une photographie instantanée, mais une lecture des trajectoires, des socialisations et des évolutions profondes. Dans cet article, nous montrons en quoi ce découpage apporte une lecture complémentaire — parfois plus pertinente — que l’analyse classique par tranches d’âge.
1. Deux logiques d’analyse : l’âge ou la génération
Les tranches d’âge regroupent les individus par périodes fixes (18-24 ans, 25-34 ans, etc.). Ce découpage est utile pour comprendre des comportements liés à des étapes de vie : insertion professionnelle, parentalité, retraite…
Le découpage par génération repose sur la date de naissance, mais surtout sur une expérience historique partagée. Il regroupe les individus ayant été socialisés dans un même contexte culturel, technologique, économique et politique. Les « Boomers » ont connu les Trente Glorieuses et mai 68, les « Y » ont grandi avec Internet, les « Z » avec le smartphone et les réseaux sociaux. Cette logique de cohorte permet donc une lecture dynamique des opinions : comment une génération évolue-t-elle dans le temps, et en quoi diffère-t-elle durablement d’une autre ?
2. Comparaison des apports : tranches d’âge vs générations
Le recours aux tranches d’âge est simple, mais il prête à certaines confusions. Par exemple, si les 18-24 ans votent majoritairement pour un parti, est-ce un effet de jeunesse (qui s’estompe avec l’âge) ou un effet de génération (qui se maintiendra au fil de la vie) ? L’analyse par génération permet de poser différemment la question.
En distinguant les effets d’âge, de période et de génération, on peut mieux interpréter les comportements. Voici cinq exemples concrets où l’analyse générationnelle peut apporter un regard différent ou complémentaire :
- Abstention électorale : on croit souvent qu’elle touche les jeunes, mais certaines générations sont durablement moins votantes que d’autres, quel que soit leur âge.
- Vote écologiste : ce n’est pas un effet d’âge, mais un réflexe plus durablement ancré chez les natifs des années 1990-2000.
- Rapport au travail : les générations Y et Z ont un rapport au travail, à l’entreprise et à la hiérarchie très différent des boomers ou de la génération X.
- Consommation d’information : le passage des médias traditionnels aux réseaux sociaux suit des logiques générationnelles plus que simplement liées à l’âge.
- Sensibilité aux enjeux sociétaux : les questions de genre, de racisme ou d’inclusion ne sont pas appréhendées de la même façon selon les générations au même âge.
Ainsi, l’analyse générationnelle permet de mieux comprendre les clivages profonds, les tendances de long terme, et les ruptures culturelles.
3. Comment définir les générations ?
Les générations sont définies de manière conventionnelle, mais leurs contours sont relativement stabilisés dans les usages :
- Baby-boomers : 1946-1964
- Génération X : 1965-1980
- Génération Y (Millennials) : 1981-1996
- Génération Z : 1997-2010
- Génération Alpha : 2011 et après
Ces regroupements permettent d’étudier des trajectoires sociales et politiques différenciées, et de comparer leurs valeurs, leurs attentes, leur rapport à la citoyenneté ou à l’action publique.
4. Enquêtes d’opinion : un découpage à intégrer dès la conception
Pour exploiter cette variable, il suffit de collecter l’année de naissance et de coder les réponses selon les générations. Ce codage peut être croisé avec d’autres variables (sexe, diplôme, territoire, etc.) pour affiner l’analyse.
Ce découpage est particulièrement utile pour :
- Comprendre les comportements politiques sur le temps long
- Détecter les fractures culturelles ou symboliques
- Explorer les usages du numérique, de l’information ou de la participation
- Anticiper les évolutions de l’opinion dans les décennies à venir
Conclusion
Le découpage par génération n’a pas vocation à remplacer les tranches d’âge, mais à les compléter. Il offre une grille de lecture originale, utile pour comprendre les dynamiques d’opinion dans le temps, au-delà des simples effets de cycle de vie. Intégrer la variable générationnelle, c’est ainsi enrichir l’analyse des comportements sociaux et politiques dans une société où les clivages se redessinent profondément.

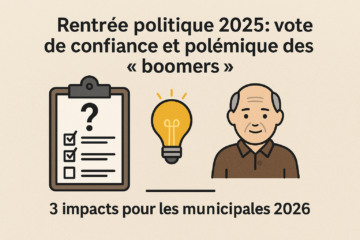
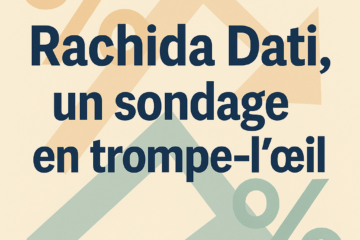

1 commentaire
Rentrée 2025 : vote de confiance & « boomers », impact local · août 31, 2025 à 1:08 pm
[…] Depuis, des propos sur les « boomers » (génération des retraités) ont déclenché une polémique.Lire notre analyse sur ce sujet […]